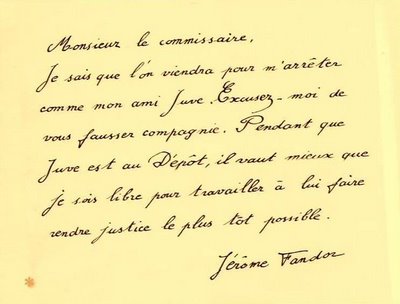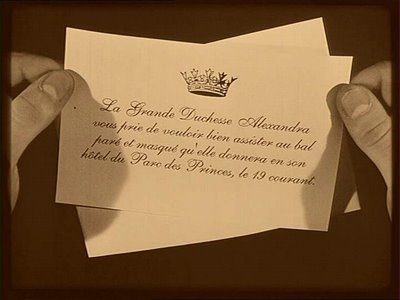Un chasseur, du nom de Michael Hulzögger, raconte un almanach de la région

Un chasseur, du nom de Michael Hulzögger, raconte un almanach de la région, partit un jour d’été de l’année 1738 pour la forêt de l’Untersberg. Il ne revint pas, et ne se montra nulle part ailleurs. On tint finalement qu’il s’était perdu ou qu’il était tombé d’une paroi rocheuse. Quelques semaines plus tard, son frère fit dire une messe pour le disparu, aux communaux où se trouve un pèlerinage aux environs de la montagne. Or, durant la messe, le chasseur entra dans l’église pour rendre grâce à Dieu de son retour miraculeux. Mais de ce qui lui était arrivé, de ce qu’il avait appris dans la montagne, il ne souffla mot, il resta muet et grave, et déclara qu’il n’y avait rien à dire de plus que ce qu’avait écrit là-dessus Lazarus Gitschner : les enfants et petits-enfants ne devaient en apprendre guère plus. Ce Lazarus Gitschner pourtant n’avait rien vu qu’une galerie sous le Königsee et l’empereur Frédéric, devenu fantôme sur le Welserberg, aussi un livre avec des prophéties et tout ce qui était déjà par ailleurs entré dans les légendes. Impossible de tirer autre chose du chasseur. Mieux, en pleine contradiction avec sa nature antérieure, il devint bientôt complètement muet. L’archevêque Firmian de Salzbourg avait aussi entendu parler de la disparition et de la réapparition énigmatique du chasseur, il le fit appeler. Mais Hulzhögger resta tout aussi muet devant le prince de l’église ; à toutes les questions il répondait qu’il ne pouvait ni ne devait rien dire de ses aventures : seule la confession lui était permise. Après la confession, l’évêque abdiqua sa charge pastorale et se tut jusqu’à sa fin. Elle ne tarda pas à survenir pour l’un comme pour l’autre : elle fut paisible, dit-on.
Ernst Bloch, Traces, traduit de l'allemand par Pierre Quillet & Hans Hildebrand, Gallimard, 1968.