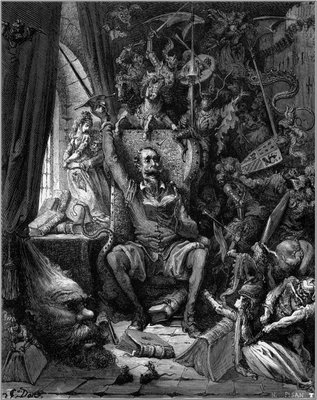Thomas Browne naquit à Londres le 19 Novembre 1605 de Thomas Browne Gentilhomme. Après avoir apris les premiers principes de la langue Latine dans l’Ecole de Wyckham près de Winchester, il entra vers le commencement de l’année 1623. dans le College de Pembrocke à Oxford, prit le degré de Maître-ès-Arts, & étudia ensuite en Medecine.
Il alla après cela en Hollande, & se fit recevoir Docteur en Medecine à Leyde ; & à son retour il fut incorporé à l’Université d’Oxford en la même qualité l’an 1637. Vers le même tems il suivit le conseil de Thomas Lushington, qui avoit été quelque tems son maître, en allant s’établir à Norwich ; & il pratiqua plusieurs années la Medecine dans cette ville avec beaucoup de réputation.
Dans la suite il fut fait Membre honoraire du College des Medecins de Londres, & vers la fin du mois de Septembre de l’an 1671. le Roi Charles II. qui se trouva alors à Norwich, le fit Chevalier.
Il mourut en cette ville le 19 Octobre 1682, âgé de 77 ans, & fut enterré dans l’Eglise de S. Pierre, où sa femme Dorothée, avec laquelle il avoit vécu pendant 41 ans, lui fit mettre cette Epitaphe.
M.S.
Hic situs est Thomas Browne M.D. & Miles, Anno. 1605. Londini natus, generosa familia apud Upton in agro Cestrensi oriundus, Schola primum Winstonensi, postea in Coll. Pembrok. apud Oxonienses, bonis litteris haud levitur imbutus; in urbe hac Nordovicensi Medicinam, arte egregia & felici successu professus; scriptis, quibus tituli, Religio Medici, & Pseudodoxia Epidemica, aliisque per orbem notissimus. Vir pientissimus, integerrimus, Doctissimus. Obiit Octobri 19 an. 1682. Pie posuit moestissima Conjux D. Dor. Br.
Catalogue de ses Ouvrages.
1. Religio Medici. (en Anglois) Londres 1642. in-8vo. Cet Ouvrage, dont il y a plusieurs éditions Angloises, a paru avec les observations de Kenelme Digby à Londres 1643. 1644. &c. in-8o & ensuite avec d’autres observations d’un Anonyme en 1654. toutes en Anglois. Jean Merryweather, Maître-ès-Arts à Cambrige, le traduisit en Latin, & il fut imprimé en cette Langue à Leyde en 1644. in-12. édition qui fut suivie de quelques autres; & principalement d’une cum Annotationibus L.N.M. Argentorati 1652. in-8vo. Ces Lettres initiales designent Levinus Nicolaus Moltkius, dont on a encore Conclave Alexandri VII. & alia Historica conjunctim edita. Slevici 1656 in-8vo. Nous en avons aussi une traduction Françoise sous ce titre: La Religion du Medecin, traduit du Latin de Thomas Brown avec des remarques 1668 in-12. L’ouvrage a été encore traduit en Italien, en Allemand, en Flammand &c. La traduction Flamande a été imprimée à Leyde en 1665. in-8vo. Tout cela montre assez l’estime qu’on en a faite, & l’avidité que chaque nation a eu de le lire en sa langue. Patin en a jugé trop malignement, à son ordinaire, lorsqu’il a dit dans une de ses Lettres. « On fait ici grand cas du livre intitulé : Religio Medici. Cette Auteur a de l’esprit. Il y a de gentilles choses dans ce livre. C’est un Melancolique agréable en ses pensées, mais qui, à mon jugement, cherche Maître en fait de Religion, comme beaucoup d’autres, & peut-être qu’enfin il n’en trouvera aucun. Il faut dire de lui, ce que Philippe de Comines a dit du Fondateur des Minimes, l’Hermite de Calabre, François de Paule; il est encore en vie, il peut aussi-bien empirer qu’amender. » Les Journalistes de Leipsic en parlent d’une maniere plus juste, lorsqu’ils disent que c’est un livre rempli d’excellents préceptes, parmi lesquels sont mêlés plusieurs paradoxes.
2. Pseudodoxia Epidemica, ou Examen des Erreurs populaires (en Anglois) Londres 1646. in-fol. La sixième édition qui parut en 1673.4 a été augmentée & corrigée par l’Auteur. C’est un excellent Ouvrage, qui renferme bien des choses curieuses. Chrétien Knorr, Baron de Rosenroth en a donné une traduction Allemande, qu’il a fait imprimer à Nuremberg l’an 1680. in-4vo sous le nom de Christophe Peganius. Il a été aussi traduit en Flamand.
3. Hydriotaphia, ou discours sur les Urnes Sepulchrales, qui ont été trouvées dans le Comté de Norfolck. (en Anglois) Londres 1658. in 8vo
4. Le Jardin de Cyrus, ou la maniere de planter les arbres en Quinconce, usitée par les anciens, examinée. (en Anglois) A la suite de l’Ouvrage précedent.
5. Ouvrage Meslés. (en Anglois) Londres 1684. in-8vo. Ce Recueil, publié après la mort de l’Auteur, par Thomas Tennison, renferme treize pieces. 1°. Observations sur plusieurs Plantes, dont il est parlé dans l’Ecriture. 2°. Des Couronnes de fleurs en usage parmi les anciens. 3°. Des Poissons, que nôtre Seigneur mangea avec ses disciples après sa Resurrection. 4°. Reponse à quelques questions sur certains poissons, oiseaux, & insectes. 5°. De la Fauconnerie chez les anciens & les Modernes. 6°. Des Cymbales. 7°. De Versibus Ropalicis, seu Gradualibus. 8°. Des langues & en particulier de la Saxone. 9°. Des Collines, des Montagnes &c. faites de main d’homme en plusieurs endroits de l’Angleterre. 10°. De la Troade par laquelle S. Paul passa. 11°. De la Reponse de l’Oracle de Delphes à Cresus. 12°. Prophetie sur l’état futur de plusieurs nations. 13°. Musæum Clausum, seu Bibliotheca abscondita.
6. Les Œuvres de Thomas Browne, (en Anglois) Londres 1686. in-fol. C’est un recueil de tous les Ouvrages précedens.
7. Œuvres Posthumes de Thomas Browne imprimés sur les Originaux. 1°. Les Antiquitez de l’Eglise Cathedrale de Norwich. 2°. Description des Urnes, qui furent decouvertes à Brampton dans la Province de Norfolk en 1667. 3°. Lettres du Chevalier Guillaume Dugdale & du Chevalier Browne. 4°. Observations meslées. On a joint la vie de l’Auteur, & une description des Antiquitez de la chapelle de S. Jean l’Evageliste, qui est aujourd’huy l’Ecole Royale de Norwich, composée par Jean Burton Maitre-ès-Arts. (en Anglois) Londres 1712. in-8vo. On est redevable de la publication de ces Oeuvres posthumes à Mr. Brigstoke qui a épousé une petite fille de M. Browne.
On a imprimé sous le nom de Browne le livre suivant.
Le Cabinet de la Nature ouvert, où l’on decouvre les causes naturelles des Metaux, des Pierres, des terres differentes &c. (en Anglois) 1657. in-12. Mais il ne peut être de Browne : puisque c’est une pure compilation tirée de la Physique de Magirus, & faite par un Ignorant, qui y est tombé en plusieurs fautes grossieres, dont Browne étoit incapable.
V. Historia Universitatis Oxoseniensis, & Athenæ Oxoniensis tom. 2, p. 714.
Jean-Pierre Niceron, Memoires pour servir à l’histoire des hommes illustres, t. XXIII (1733).